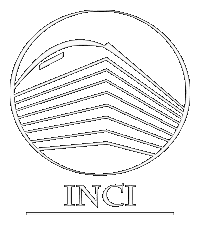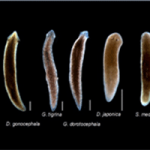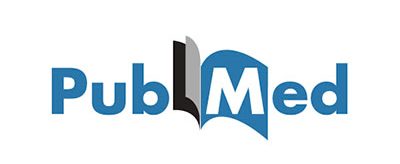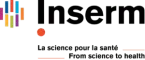Régulation et perturbation des rythmes neuroendocrines
Etienne CHALLET & Valérie SIMONNEAUX

Présentation
 Les objectifs de l’équipe 7 sont d’analyser les mécanismes d’adaptation ou de mauvaise adaptation des organismes aux changements environnementaux, en tirant partie de la biodiversité des processus physiologiques utilisés par les différentes espèces animales.
Les objectifs de l’équipe 7 sont d’analyser les mécanismes d’adaptation ou de mauvaise adaptation des organismes aux changements environnementaux, en tirant partie de la biodiversité des processus physiologiques utilisés par les différentes espèces animales.
Les membres de l’équipe étudient les mécanismes de synchronisation quotidienne et saisonnière des fonctions métaboliques et reproductives, et évaluent l’impact des perturbations environnementales (exposition à la lumière nocturne, décalages horaires aigus ou chroniques, alimentation déséquilibrée, perturbateurs endocriniens) sur ces fonctions rythmiques.
Ces recherches seront menées avec une approche comparative sur une variété de modèles animaux conventionnels (rat, souris) et non conventionnels (planaires, rongeurs diurnes et saisonniers, grands mammifères).
1. Bases neuroendocrines des rythmes biologiques
Cet axe vise à identifier les mécanismes neuroendocriniens par lesquels les horloges centrales et horloges périphériques contrôlent les rythmes physiologiques pour assurer une adaptation optimale des espèces à leur environnement rythmique. Plus particulièrement, nous étudions deux processus physiologiques hautement intégrés, le métabolisme énergétique et la reproduction. D’une part, nous étudions comment les horloges cérébrales régulent le cycle quotidien d’alimentation/jeûne et l’anticipation de la prise alimentaire, et comment ces horloges sont réinitialisées par des signaux métaboliques ou d’éveil chez des modèles animaux nocturnes et diurnes. D’autre part, nous étudions comment l’hypothalamus régule non seulement les cycles de reproduction journaliers/ovariens/saisonniers, mais également les mécanismes d’adaptation aux saisons via l’hibernation, la neurogliogenèse et la programmation maternelle.
1.1. Liens fonctionnels entre horloges cérébrales et facteurs d’éveil ou nutritionnels
Sylvie Raison, Stéphanie Dumont, Patrick Vuillez, Etienne Challet
1.2. Mécanismes neuroendocriniens impliqués dans la régulation des fonctions saisonnières
Valérie Simonneaux, Paul Klosen, Aurélia Ces, Vincent Joseph Poirel, Vebjorn Melum, Louise Sicot
2. Impact des perturbations environnementales sur les rythmes neuroendocriniens
Cet axe vise à comprendre l’impact des perturbations environnementales (exposition à la lumière nocturne, décalages horaires aigus ou chroniques, alimentation déséquilibrée, perturbateurs endocriniens, champs magnétiques et électromagnétiques) sur les fonctions rythmiques. Notre hypothèse est que les facteurs de synchronisation capables de remettre les horloges circadiennes à l’heure deviennent des désynchronisateurs lorsqu’ils sont perçus/fournis à des moments inappropriés du cycle journalier, ce qui déclenche ou favorise des effets néfastes sur la santé. En outre, comme les fonctions saisonnières dépendent d’actions hormonales finement régulées, nous supposons que la perturbation de cet orchestre hormonal par des facteurs physiques ou des produits chimiques exogènes peut altérer la saisonnalité des organismes.
2.1. Effet de la perturbation des cycles journaliers (travail posté, lumière nocturne)
Etienne Challet, Valerie Simonneaux, Stéphanie Dumont, Nathalie Jeandidier, Thibault Bahougne, Elisa Nied
2.2. Effet d’une alimentation déséquilibrée
Clémentine Fillinger, Stéphanie Dumont, Patrick Vuillez, Etienne Challet, Pablo Saïdi-Ploussard
2.3. Effet des perturbateurs endocriniens sur les rythmes de la reproduction et du métabolisme
Valérie Simonneaux, Paul Klosen
2.4. Effets des champs magnétiques et électromagnétiques sur les rythmes circadiens
Hervé Cadiou, Yannick Menger, Guillaume Reho

Paul Klosen
(MC Unistra)

Valérie Simonneaux
(DR CNRS)

Patrick Vuillez
(MC Unistra)

Yannick Menger
(CDD AI 100%)

(doctorant)
La lumière ambiante joue un rôle essentiel dans la régulation de notre physiologie, non seulement par des effets directs, mais aussi par son influence sur nos horloges circadiennes qui contrôlent le cycle de veille-sommeil et le rythme d’alimentation-jeûne. Si la lumière pendant la journée a des effets bénéfiques pour la santé, la pollution lumineuse nocturne, causée par les écrans ou le travail de nuit, peut perturber le métabolisme. Mon projet de thèse vise à comprendre comment la lumière modifie la prise alimentaire et le métabolisme au cours d’un cycle journalier chez des modèles animaux diurnes et nocturnes. L’objectif à terme de ce projet est de développer de nouvelles approches chronothérapeutiques pour traiter ou prévenir les déséquilibres métaboliques, notamment en lien avec le diabète et l’obésité.
(encadré par E. Challet)

(doctorante)
L’infertilité représente un enjeu sociétal majeur et plusieurs études indiquent qu’un système circadien fonctionnel et bien synchronisé est nécessaire au bon fonctionnement des cycles reproducteurs et à la fertilité féminine. En s’appuyant sur un large éventail de techniques telles que la photométrie à fibre et la bioluminescence, mon projet de recherche doctoral vise à tester l’hypothèse selon laquelle une perturbation du cycle lumière/obscurité, telle que vécue par les travailleuses postées, altère le rythme et la fonction de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien chez la souris femelle, ce qui pourrait négativement impacter la fertilité.
(encadrée par V. Simonneaux)
Guillaume Reho (doctorant) :
La douleur peut se définir par deux composantes : une sensorielle et une émotionnelle. La composante sensorielle, c’est ce qu’on appelle la nociception. Elle représente l’ensemble des récepteurs et cellules nerveuses qui vont s’activer quand un tissu est soumis à un stimulus nocif. La nociception est principalement étudiée chez les vertébrés, mais elle est aussi présente chez un grand nombre d’animaux invertébrés qui sont sous-représentés. C’est dans ce cadre que mon sujet de thèse s’intéresse à la nociception de la planaire, un petit vers plat d’eaux douces, et à la façon dont on peut moduler leurs réactions face à un stimulus désagréable, comme le font les analgésiques pour nous. Etudier la nociception chez les invertébrés nous permet de mieux comprendre comment la douleur s’est construite au cours de l’évolution et quels sont ses principes fondamentaux, nous permettant ainsi de mieux la traiter.
(encadré par H. Cadiou)

(doctorante)
J’étudie les variations saisonnières de la prolifération cellulaire dans une région spécifique du cerveau, l’hypothalamus. Cette région est impliquée dans la régulation de fonctions physiologiques telles que la reproduction ou le métabolisme énergétique. Mon projet de recherche réalisé chez le hamster Syrien, un modèle de rongeur saisonnier, consiste à identifier les signaux saisonniers qui régulent la prolifération cellulaire hypothalamique, à déterminer les mécanismes cellulaires impliqués, ainsi qu’à caractériser le rôle physiologique de la saisonnalité de la prolifération cellulaire hypothalamique.
(encadrée par V. Simonneaux)

(doctorant)
Les espèces sauvages sont exposées à de fortes variations saisonnières de leur environnement. J’étudie les mécanismes neuroendocrines impliqués dans l’anticipation de la physiologie à ces variations environnementales. J’étudie notamment le rôle des tanycytes dans la programmation maternelle saisonnière et dans les cycles d’hibernation.
(co-encadré par V. Simonneaux & S. Wood)